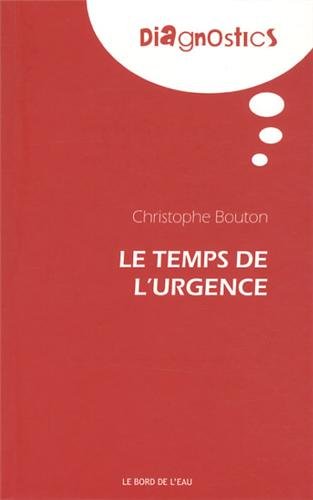C. Bouton, Le Temps de l’urgence, Paris, Le Bord de l’eau, 2013, 303 p.
L’essai de Christophe Bouton s’inscrit dans un ensemble de recherches déjà bien fourni. Depuis quelques années, on observe une inflation d’essais sur la vitesse, l’accélération, l’agitation de la vie quotidienne ou la frénésie au travail [1]. Mais le point de vue qui y est exposé tranche sur la plus grande partie de ces travaux et cela pour un nombre non négligeable de raisons.
L’urgence comme norme temporelle de l’action
La première originalité de l’approche de Bouton concerne la définition du problème lui-même. Dès l’introduction, l’auteur montre l’insuffisance des approches, aujourd’hui à la mode, qui se concentrent sur la vitesse ou l’accélération [2]. Certes, l’accélération des progrès techniques, celle du tempo de la vie quotidienne et du travail, ou encore celle des transformations sociales peuvent entraîner une pression et une course incessantes, avec toutes les conséquences négatives que l’on connaît. Mais il existe des vitesses et des accélérations sans urgence et donc sans effets préjudiciables : par exemple, un déplacement en TGV ou l’utilisation récréative ou associative d’Internet (p. 32). On pourrait ajouter qu’il existe des lenteurs et des décélérations mortifères : celles du chômage ou de la relégation, pour les prisonniers [3] ou certaines personnes âgées. Toute vitesse et toute accélération ne sont donc pas en soi mauvaises ; toute lenteur et toute décélération pas toujours bonnes [4].
Par ailleurs, l’urgence ne se limite pas à la sensation ou au sentiment d’être pressé, stressé voire violenté ; il ne s’agit pas d’un simple fait subjectif. L’urgence constitue un « phénomène social total » (p. 16) [5], un fait « systémique » (p. 19), qui, certes a des dimensions psychologiques, mais qui se manifeste dans tous les secteurs de la vie sociale et dont on peut repérer les origines géographiques (les pays industrialisés) et historiques (la fin du XVIIIe siècle « avec les débuts de la révolution industrielle et l’essor du capitalisme ») (p. 27) : « Il y a une géographie et une historicité de l’urgence. Le fait que ce phénomène soit concentré dans les sociétés fortement industrialisées montre que cette norme temporelle a été construite petit à petit au cours de l’histoire. » (p. 103)
Enfin, dans la mesure où elle est une réalité historique et sociale, au sens durkheimien que donne Bouton à ce terme, on peut définit l’urgence comme une « norme temporelle de l’action » : « L’urgence est une norme sociale du temps. Elle prescrit un rapport déterminé de l’individu au temps, un certain usage du temps : le temps est considéré comme un capital immatériel que l’individu doit rentabiliser et faire fructifier en permanence, une ressource rare qu’il s’agit d’exploiter au maximum. Pour cela, il lui faut accomplir toujours plus d’actions en une durée toujours plus courte. » (p. 103) Au lieu d’être simplement technique ou psychologique, le problème auquel nous sommes aujourd’hui confrontés relève donc de la diffusion d’une nouvelle norme ou, pour être plus précis, de la généralisation à toute la société d’une norme qui existait déjà mais qui était restée circonscrite à certains milieux – l’urgence hospitalière, l’urgence des secours en mer ou contre l’incendie : « Tout le problème de l’urgence vient de ce qu’elle s’est peu à peu affranchie de son état d’exception pour devenir un état durable, une règle, une norme sociale qui se généralise et s’impose dans les sociétés modernes de type occidental comme le rapport normal au temps. » (p. 110)
Les nouveaux domaines de l’urgence
Deuxième originalité de l’approche développée par Bouton : la présentation des faits. Contrairement à de très nombreux essais concernant la vitesse ou l’accélération qui ne s’embarrassent guère des données empiriques ou ne citent que celles qui vont dans le sens de leurs spéculations, Bouton s’astreint à décrire dans la première partie de son livre, de manière très minutieuse, « l’extension du domaine de l’urgence », dans l’économie, le travail, la vie quotidienne, le droit, la politique, l’environnement, l’éducation, les médias. Il y manque juste, pour se limiter à la liste envisagée par Mauss pour définir le concept de « fait social total », les aspects morphologiques, religieux et esthétiques. Je reviendrai plus bas sur ces absences [6].
Cette partie est l’occasion pour l’auteur de rappeler un certain nombre de faits connus, mais dont on ne peut sous-estimer l’importance, concernant l’évolution de l’organisation scientifique du travail, depuis le taylorisme et le toyotisme jusqu’aux nouvelles techniques de management par équipes et par compétition interne apparues dans les dernières décennies du XXe siècle [7]. À l’aube du XXIe siècle, le temps de travail apparaît ainsi comme un temps « densifié, compressé, imposé mais aussi contrôlé » (p. 49). Outre les conséquences néfastes de ces transformations, la perte de la satisfaction de « l’ouvrage bien fait » et une certaine « détresse du monde du travail » (p. 34), la fatigue, le surmenage, la dépression, le burnout voire, dans certains cas, comme à France Telecom, le suicide, Bouton souligne à raison leur effets anthropologiques de fond : « Les techniques de management moderne ont façonné un homme nouveau, elles ont converti l’homo œconomicus en homo temporalis. Le salarié doit être le leader de soi-même et gérer sa vie comme une micro-entreprise. » (p. 65) De ce point de vue, l’urgence signifie la fin d’une certaine culture de la vocation et de tous les projets conçus à l’échelle d’une vie, tels le « métier » ou le « mariage ».
La pénétration de l’urgence dans les autres sphères de l’existence – la vie quotidienne, le droit, la politique, l’environnement, l’éducation, les médias – fait l’objet de descriptions tout aussi instructives mais dont l’espace alloué à cette recension interdit de rendre compte comme il conviendrait.
Les dégâts de l’urgence
Troisième originalité : la construction et l’évaluation des faits. Tout en donnant à l’empirique, on vient de le voir, la part qui lui revient, Bouton s’oppose ici à toutes les approches empiristes et positivistes, de plus en plus envahissantes aujourd’hui, qui se retranchent derrière le pseudo-principe de neutralité épistémo-axiologique. Contrairement à nombre de ses contemporains, Bouton sait non seulement que les « faits » ne se donnent pas d’eux-mêmes et sont toujours construits à partir d’un point de vue, mais aussi qu’ils ne prennent sens que lorsqu’ils sont jugés à l’aune de critères normatifs.
La deuxième partie de l’ouvrage, intitulée « les dégâts de l’urgence », décline ainsi ses conséquences néfastes sur notre perception de l’existence, notre psychisme et notre corps. Et c’est alors l’occasion pour Bouton d’approcher son objet cette fois en multipliant les points de vue critiques.
Reprenant à son compte l’interprétation de Hartmut Rosa, qui faisait elle-même écho à une thèse célèbre soutenue par Jürgen Habermas, Bouton commence par souligner la contradiction introduite dans la culture moderniste – au moins dans sa tendance principale – par la diffusion de la norme temporelle de l’urgence. Alors que le projet éthique et politique mis en place par les Lumières promettait à chacun son autonomie, celle-ci introduit une « hétéronomie temporelle, au sens où les normes temporelles qui régissent la vie sociale, au sommet desquelles se tient l’urgence, s’imposent aux individus contre leur gré » (p. 123). Bien qu’il présente étrangement ce premier critère d’évaluation comme un critère « interne au système de valeurs de l’urgence » (p. 119), ce point de vue permet à Bouton d’introduire le concept d’aliénation, qui lui servira d’axe principal d’interprétation dans la fin de son essai : « On n’hésitera pas à parler, avec Hartmut Rosa, d’“expérience de l’aliénation”, en soulignant qu’il s’agit avant tout d’une aliénation temporelle, d’une hétérochronie. » (p. 123)
Puis l’auteur reprend la critique psycho-sociologique commencée dans la première partie à propos du travail et la généralise à toute la société. À la perte de la satisfaction de l’ouvrage bien fait, la fatigue, le surmenage, la dépression, le burnout et le suicide, s’ajoutent chez l’homme en état d’urgence – la « time-urgent personality » décrite par Robert Levine [8] – des transformations psychiques qui confinent parfois à la pathologie : le sentiment de manquer de temps, l’impatience, l’obsession de la ponctualité, la manie de tout planifier en détail, même dans les moments de temps libre, la concentration exclusive sur les intérêts professionnels aux dépens de la vie privée, les insomnies, les idées fixes.
L’étape suivante consiste en une critique phénoménologique de la « temporalité de l’urgence ». Celle-ci prolonge à sa manière la mesure, l’homogénéisation et la dénaturalisation de plus en plus parfaites du temps, qui ont été de nombreuses fois analysées depuis Bergson, entre autres dans les travaux de Le Goff [9], Thompson [10], Landes [11] et Elias [12], que Bouton ne manque pas de citer. Comme le « temps spatialisé », « l’urgence provoque une discordance entre le temps subjectif de l’individu et le temps social dans lequel il travaille » (p. 139). Et cela au moins à trois niveaux emboîtés les uns dans les autres. Lorsqu’il est envahi par l’urgence, le temps quotidien, qui selon Bruce Bégout constitue un « mélange bien dosé entre répétition et nouveauté », une « discrète harmonie », se transforme en « temps du besoin et du souci », en « notes dissonantes et en cacophonie » (p. 141). De même, le temps plus vaste de la vie perd à la fois l’ouverture de « l’horizon d’attente » qui lui était garantie par la promesse moderniste (Koselleck), « le champ d’expérience » que lui assurait la possibilité de rassembler son passé dans des récits (Ricœur) et le présent auquel il semble se réduire et qui pourtant n’est qu’un « présent dérobé » (p. 146). De même encore, le temps de l’histoire perd sa dynamique et son orientation en se séparant du temps individuel : « Nous nous désolidarisons de l’histoire présente. Le temps de l’urgence est un temps déshistoricisé. » (p. 159)
À ces trois premiers éclairages critiques, Bouton en ajoute un quatrième sur lequel je voudrais insister un peu car il constitue, à mon avis, l’un des apports les plus originaux du livre. Ce dernier point de vue, Bouton le construit en effet à partir d’un attelage inattendu associant une ligne de pensée marxienne et une ligne tirée de l’expérience artistique et tout particulièrement littéraire.
Du côté marxien, il reprend une critique classique que l’on trouve déjà chez Marx et qui a été illustrée de nombreuses fois pas la suite, en particulier dans la première moitié du XXe siècle par Georges Friedmann [13] et encore récemment par Nicole Aubert [14] et Richard Sennett [15]. Comme le travailleur n’est plus qu’un rouage dans un processus de fabrication qui le dépasse, « il ne lui est plus possible de se reconnaître dans l’objet qu’il a fait, d’en retirer une fierté, une satisfaction. Le taylorisme, le toyotisme et le néo-taylorisme ont accentué ce désœuvrement du travail, en diminuant de plus en plus la part de créativité » (p. 178). C’est pourquoi, l’urgence, qui a pénétré depuis ces dernières décennies le monde du travail, est en train de le stériliser encore un peu plus : « En provoquant une hyperactivité qui rabat la créativité du travail sur la production standardisée de biens ou de services, l’urgence engendre un désœuvrement au sein même du travail salarié, un travail désœuvré, au sens où elle enlève au travail ses propriétés qui lui permettent de “faire œuvre”. » (p. 178) Vu l’importance du temps de travail dans nos vies, cette dégradation entraîne finalement une dégradation analogue de la vie tout court : « Finalement, c’est la vie elle-même qui finit par être désœuvrée, au sens où elle est dépossédée de son style et de sa puissance créatrice. » (p. 179).
Il me semble remarquable que Bouton associe cette tradition critique marxienne, à une approche qu’il faut appeler poétique, au sens de la poétique, même si Bouton n’utilise pas le mot : « L’œuvre est une réserve inépuisable de sens, en attente d’interprétations futures toujours nouvelles. Cette temporalité spéciale de l’œuvre, qui fait se prolonger le temps de la vie dans le temps de l’histoire, a été maintes fois célébrée. » (p. 180). Et Bouton de citer Le Temps retrouvé où Proust « souligne la capacité des œuvres à nourrir les générations futures […] “pour que pousse l’herbe non de l’oubli mais de la vie éternelle, l’herbe drue des œuvres fécondes, sur laquelle les générations viendront faire gaîment, sans souci de ceux qui dorment dessous, leur ʻdéjeuner sur l’herbeʼ” » (p. 180). Le diagnostic qui est tiré de cette approche corrobore le diagnostic marxien d’un travail désormais sans œuvre mais il le porte à la dimension globale de la culture : « En quoi l’urgence peut-elle provoquer un processus de dés-œuvrement, de décomposition de l’œuvre ? C’est que le temps de l’urgence et le temps de l’œuvre ne sont guère compatibles. L’urgence impose un mode de production répétitif et standardisé, où la création n’a pas de place. […] Dès lors qu’elles sont produites dans l’urgence, les œuvres n’ont pas les qualités qui leur permettent de perdurer. » (p. 181)
Le résultat de cette rencontre de la pensée marxienne et de la poétique débouche sur une critique dont il faut souligner la force dans la mesure où elle vise l’organisation temporelle même de nos vies, c’est-à-dire leurs rythmes : « Toute urgence implique une limitation plus ou moins grande de liberté, qui va de l’interdiction de choisir ses gestes sur une chaîne de montage à l’impossibilité de décider du sens de sa vie. La liberté, entendue en un sens temporel, consiste à être, dans certaines limites, maître de son temps. […] L’urgence est un esclavage moderne […] une aliénation d’un genre nouveau. L’emploi du temps, le rythme de travail, l’organisation des projets échappent de plus en plus au contrôle des intéressés […] L’urgence est la négation du temps à soi. » (p. 186-87)
Le capitalisme comme cause structurante de l’urgence
Quatrième originalité : l’explication des faits. La troisième partie de l’ouvrage explore les différents facteurs qui peuvent rendre compte des faits accumulés et évalués précédemment.
À la différence de la plupart de ses contemporains, Bouton rejette l’idée d’un simple pluralisme des causes de l’urgence. Robert Levine identifie, par exemple, cinq facteurs principaux qui détermineraient « les rythmes de la vie » : la santé de l’économie, le degré d’industrialisation, la taille des regroupements de population et des villes, le climat et le degré d’individualisme. Hartmut Rosa attribue, quant à lui, « l’accélération » à trois moteurs principaux : l’accélération du rythme de la vie serait entraînée par les promesses d’émancipation de réalisation de soi de la modernité ; l’accélération technique serait soumise aux exigences du capitalisme et à la diffusion de l’économie monétaire et financière ; enfin, l’accélération du changement social s’alimenterait dans l’accentuation de la différenciation fonctionnelle provoquée en partie par la mondialisation.
Bouton ne récuse pas entièrement ces explications mais il en conteste l’absence de hiérarchisation et, quand ce n’est pas le cas, la tendance assez fréquente à mettre en avant le facteur technique. Pour lui – et on ne peut que lui donner raison –, il n’y a aucun déterminisme de la technique (p. 238-39). Cette idée sert surtout, comme chez Heidegger (p. 212), à ne pas nommer les causes réelles qui sont soit idéologiques, soit économiques : « L’accélération technique reste de ce point de vue largement dérivée de l’accélération économique. » (p. 192)
Pour Bouton, qui se place clairement ici dans une lignée marxiste, il faut rendre au capitalisme ce qui lui appartient : « Contre cette grille de lecture, les arguments ne manquent pas pour soutenir que le capitalisme est non pas la cause unique, mais la cause structurante de l’urgence, sans laquelle les autres causes concomitantes n’auraient pas un tel pouvoir de contrainte. » (p. 192)
La cause principale de la diffusion de l’urgence se trouve dans la reprise de la course à la productivité qui caractérise le capitalisme, depuis que, dans les années 1990, celui-ci, sous la pression des marchés financiers, a commencé à exiger une rentabilité de 15 % par an sur les capitaux investis. C’est pourquoi, « l’urgence n’est pas seulement un effet collatéral de l’augmentation du profit, mais sa condition même : l’urgence est le prix à payer par les salariés pour satisfaire la course en avant de la productivité » (p. 61). Et Bouton de citer à ce propos l’excellent travail de Nicole Aubert : « Ce qui unit les trois premiers concepts d’urgence, instantanéité et immédiateté […], c’est celui de vitesse, elle-même au cœur du système capitaliste : plus le capital tourne vite et plus le taux de profit annuel est élevé, d’où la recherche effrénée d’accélération qui imprègne toute l’histoire du capitalisme. » (Le culte de l’urgence, cité p. 193)
Précisons que cette détermination « en dernière instance » par le capitalisme ne fait pas retomber Bouton dans le réductionnisme économique qui a été le propre d’un certain marxisme. Non seulement il conserve en effet le principe d’un pluralisme des causes, mais toute la troisième partie de son livre est consacrée à examiner l’articulation du facteur économique aux autres.
Après un examen rapide des motivations psychologiques qui peuvent expliquer l’attrait qu’exerce l’urgence chez certaines personnes et sur lesquelles tentent de s’appuyer l’idéologie du néo-management – le sentiment de toute-puissance, le plaisir des montées d’adrénaline, le désir de reconnaissance sociale, la peur sécularisée de la mort –, Bouton s’interroge sur sa transformation historique en norme sociale. Or, d’une manière aussi inattendue et aussi féconde que lorsqu’il attelait Marx et Aristote, la critique de l’économie politique et la poétique, il interprète celle-ci comme la mise en place d’une « discipline », au sens foucaldien du terme : « L’hypothèse explorée ici est que l’émergence de l’urgence a été rendue possible par la mise en place progressive d’un temps disciplinaire, lié à l’usage des calendriers et des horloges. » (p. 200)
Selon Foucault, comme on sait, la discipline, introduite à partir du XVIIe siècle dans les prisons, les hôpitaux, les hospices et les asiles, les institutions d’enseignement et les orphelinats, puis au siècle suivant dans les manufactures et bientôt les usines, quadrille le temps, l’espace et les mouvements de corps. Elle a pour objectif de mettre en place des formes particulières d’individuation [16]. Or, ce nouvel éclairage a tendance à assouplir ce qu’avait d’un peu réducteur le déterminisme économique marxiste. En effet, les disciplines ne sont pas nées, comme on aurait pu s’y attendre du point de vue d’un économisme pur, dans les manufactures et les usines ; elles ont été testées et développées au cours des deux siècles précédents dans des institutions non productives. Ce qui relie les transformations de ces sphères de la vie sociale à celles de l’économie, c’est la question de l’organisation temporelle de la vie des individus, c’est-à-dire du rythme : « Dans le système capitaliste comme dans le système pénal qui remplace les châtiments corporels par la prison, le temps de l’individu devient un enjeu de pouvoir. Dans un cas, on extrait de l’ouvrier le maximum de temps de travail. Dans l’autre, on retire au condamné du temps de vie par la fixation de la peine en nombre de mois et d’années. […] Dans la société disciplinaire, le temps de l’individu est l’objet d’une domination, d’un assujettissement » (p. 209).
Toutefois, fait remarquer Bouton, critiquant au passage Foucault, à partir du XIXe siècle et de la Révolution industrielle, la causalité s’est renversée : « C’est parce que les ateliers, les manufactures ont eu besoin d’une certaine forme de discipline du temps, alliant ponctualité et célérité, que celle-ci a pu être intégrée dans des institutions non productives comme l’école. » (p. 210) Au moins depuis cette époque, le capitalisme est devenu la cause dominante de l’évolution des rythmes : « Le mode de production capitaliste est plus qu’un facteur parmi d’autres dans la genèse de la discipline du temps, il en est l’initiateur – la ruche infatigable d’où procède l’essaimage de l’urgence dans les différents domaines de la société. » (p. 210)
Suit une section assez longue consacrée à analyser « l’économie du temps » qui est sortie de cette « grande transformation ». Bouton l’envisage, tout d’abord, mais sans y insister, d’un point de vue phénoméno-ontologique : l’« arraisonnement de la nature » dénoncé par Heidegger s’accompagnerait d’« un arraisonnement du temps : à l’ère de la technique, il est devenu lui aussi une “ressource”, qui doit être quantifiée, extraite, exploitée, consommée de diverses manières » (p. 213). Puis il en reprend la généalogie historique bien connue : l’apparition du « temps de marchands » à la fin du Moyen Age mis en évidence par Jacques Le Goff, la diffusion au cours de l’ère moderne « des horloges et des montres » soulignée par David S. Landes, enfin, la « capitalisation du temps » à partir de la Révolution industrielle, analysée en détail par Marx. Après une période où le marxisme a presque disparu, on lira avec profit les analyses élémentaires mais claires consacrées par Bouton à la question du temps dans Le Capital : « Le capitalisme est au fond une affaire de temps. Le temps intervient en effet aussi bien dans sa conception de la valeur que dans la production de la plus-value. » (p. 219)
Ces réflexions amènent Bouton à nouer cette approche marxiste à ses analyses précédentes concernant la nouvelle norme disciplinaire temporelle et à proposer un diagnostic en quatre temps dont la concision n’égale que la clarté. Plutôt que de le résumer, je vais donc le citer abondamment.
Premièrement, l’urgence est une donnée fondamentale du capitalisme. Comme l’augmentation de la productivité entraîne à terme une diminution des prix des biens produits et donc des profits, les capitalistes n’ont d’autre choix que de se livrer à une course infinie à la productivité ou disparaître : « On comprend, dès lors, le caractère “révolutionnaire” du capitalisme, le bouleversement perpétuel qu’il introduit dans la société, son goût presqu’irrationnel pour l’innovation. Il ne peut exister qu’en modifiant constamment les conditions de la production. » (p. 229)
Deuxièmement, la caractérisation marxienne du capitalisme comme un système de production fondé sur sa propre révolution permanente s’est avérée exacte pour les deux derniers siècles – et elle continue à l’être aujourd’hui : « Dans sa phase néolibérale, le capitalisme accentue cette tendance à la liquéfaction ou mieux, à la liquidation totale de toute stabilité. En érigeant la compétition en norme de vie, il transforme l’homo œconomicus en homo mutabilis astreint à l’adaptabilité au flux toujours plus rapide du marché, qui ne tolère aucun arrêt. » (p. 231)
Troisièmement, pour les travailleurs, le coût de ce système de production est extrêmement élevé et porte en premier lieu sur le rythme de leur vie : « Le temps est réduit à une marchandise (l’ouvrier vend au fond du temps de travail disponible), soumis à une discipline (le temps de travail est pris dans un réseau de normes socio-économiques contraignantes) et soustrait à la maîtrise du salarié (lequel n’a en réalité ni le choix ni même le droit de refuser l’allongement de sa journée de travail). On peut parler d’aliénation temporelle, dans la mesure où le salarié perd le contrôle de la durée de son travail ainsi que de son rythme, dicté par la cadence des machines. » (p. 224) Plus loin : « Dans le capitalisme, le temps de travail, qui est la première variable d’ajustement, est non seulement quantifié, homogénéisé, discipliné, mais il est aussi, sous l’effet de la course à la productivité, compressé, densifié, accéléré dans son tempo. Le capitalisme apparaît comme un puissant moteur de l’urgence. » (p. 230)
Quatrièmement, cette leçon, qui était déjà valable au XIXe siècle, l’est encore plus clairement aujourd’hui dans la mesure où l’urgence s’est propagée de la sphère économique où elle est née à toutes les autres sphères de l’existence : « Le mode de production capitaliste a forgé une discipline du temps spécifique, fondée sur la notion de rentabilité, qui a ensuite essaimé dans les autres champs de la société sous la forme d’une norme sociale du temps. » (p. 231)
Comment arrêter l’urgence
Cinquième originalité : les solutions envisagées pour arrêter ou désamorcer l’urgence. Bouton se démarque là encore très nettement de ses contemporains, dont il rejette, non sans les avoir discutées en détails, la plupart des propositions – qui ne sont du reste pas si nombreuses.
Dans cette quatrième et dernière partie du livre, il s’en prend, tout d’abord, avec une grande justesse, à quatre attitudes fréquemment adoptées à l’égard de la diffusion de l’urgence : le catastrophisme à la Sloterdijk – mais il aurait pu citer également Virilio – qui se discrédite de facto chaque jour un peu plus dans la mesure où le « grand accident » annoncé n’arrive pas ; la banalisation qui ne propose qu’une adaptation à un monde de plus en plus injuste et dur ; la psychologisation qui refuse de voir l’aspect social du problème et se replie sur des solutions individuelles à portée très limitée ; enfin, le fatalisme dans ses différentes versions, « sceptique » (l’urgence a toujours existé et fait partie de la nature humaine), « philosophie de l’histoire » (elle s’inscrit dans une évolution historique irréversible), « prix à payer » (elle est le prix du choix d’une société de consommation et d’abondance), ou « mondialisation » (elle est devenue une réalité mondiale et donc impossible à maîtriser par un accord entre les acteurs). Aucune de ces attitudes ne donne de clés pour s’opposer à l’invasion de nos vies par l’urgence, si bien qu’elles en constituent finalement de simples formes d’acceptation assez lâches.
Bouton examine ensuite les postures plus combattives – ou au moins qui se présentent comme telles. En ce qui les concerne, il souligne de nouveau les effets délétères de la confusion entre la vitesse et l’urgence présupposée par la plupart de ces postures : « Si la lutte contre l’urgence est identifiée à la critique de la vitesse et de l’accélération, elle peut sembler non seulement réactionnaire et passéiste, mais surtout vaine et irréaliste. Le problème est non l’accélération en soi, mais l’accélération comme auxiliaire ou conséquence de l’urgence. » (p. 248) Ces théories ne peuvent apporter de réponses satisfaisantes car, d’emblée, elles posent mal le problème. Il ne s’agit pas d’un problème de vitesse mais de rythme et plus précisément encore de qualité des rythmes de nos vies : « Il ne s’agit pas de ralentir en général, mais de décompresser le temps, d’assouplir le carcan temporel, de freiner la course à la productivité dans l’organisation du travail. » (p. 248) Et de fait, le plus souvent ces discours « critiques » ne débouchent que sur des déplorations ou bien des propositions illusoires comme celles d’établir des « îlots de décélération » au milieu des courants toujours plus rapides qui balayent notre monde.
Cette confusion, entretenue au niveau théorique depuis des années par Paul Virilio et plus récemment par Hartmut Rosa, est présente également dans ces autres formes de critique, moins tonitruantes mais tout aussi à la mode, que constituent les mouvements Slow et dont Bouton pointe avec justesse les limites : « Le Slow Time est pour le moins ambigu. On ne sait pas toujours si l’on a affaire à un esprit de rébellion contre l’urgence, ou à une vaste supercherie. S’il peut être parfois un grain de sable dans les rouages de l’urgence, un frein à son extension, il est aussi un gain potentiel pour le capitalisme, soit en amont du côté de la production, par des techniques de management subtiles, soit en aval du côté de la consommation. » (p. 263) En ce qui concerne la production, Bouton fait ainsi remarquer que « certaines formes de Slow Time adhèrent au culte de la performance et visent simplement à renforcer la productivité des salariés. L’argument de marketing est alors qu’“aller moins vite, c’est aller bien plus vite”. » (p. 263) Et l’auteur de conclure en reprenant l’un des auteurs qui connaît mieux cette mode, pour y avoir participé, Carl Honoré : « Il s’agit de “donner un visage humain” au capitalisme, voire de lui fournir “une bouée de sauvetage”, sans pour autant envisager des mesures politiques susceptibles de le réglementer. On ne traite que les effets en se gardant de critiquer les causes, que l’on cherche au contraire à rendre supportables. » (p. 263) S’agissant de la consommation, Bouton souligne le fait indéniable que le Slow Time est en train de connaître le même sort que le thème des « loisirs » dans les années 1960-70 : « Il est détourné, récupéré par le capitalisme, afin de créer un nouveau marché de la lenteur, dans lequel le “slow” n’est plus qu’un label destiné à faire vendre des produits ou des services, souvent plus onéreux. » (p. 263) Conclusion : « L’idée d’un salut par la lenteur n’est qu’une illusion, tant qu’elle ne s’attaque pas aux causes structurelles du problème. » (p. 266)
Toutefois, Bouton ne condamne pas en bloc les mouvements Slow et il trouve, par exemple, quelques attraits au projet d’une Slow Education, qui « s’avère nécessaire de l’école aux universités en passant par les grandes écoles, en train de devenir, sous la pression des normes managériales, des “classes préparatoires à la mobilisation” » (p. 264), ou encore à celui d’une Slow Science, qui cherche à rétablir dans le monde académique « la skholè, ce loisir qui est la condition de la recherche et de la créativité » (p. 265). On ne peut qu’être d’accord avec lui.
Ajoutons, pour être complet, qu’au cours de ces discussions, Bouton opère petit à petit un double rejet : celui des réponses individuelles, d’abord, mais aussi, bientôt, celui des réponses collectives de type révolutionnaire. Les premières ne constituent que de fausses solutions qui visent « à se ménager des petits îlots de loisir, des oasis de tranquillité » tout en reportant la pression de l’urgence sur des subordonnés (p. 251), quand elles ne sont pas de simples entreprises d’adaptation, plus ou moins illusoires, fondées sur l’allégement de la pression de l’emploi du temps par quelque séance de tai-chi, de yoga ou de sophrologie (p. 252). Toutes ces stratégies reconduisent la norme de l’urgence sans pouvoir en atteindre les causes (p. 258). En ce qui concerne les secondes, on pourrait s’étonner, vu l’importance qu’il donne à Marx, qu’il les écarte également mais Bouton se retranche ici derrière ce qu’il présente comme un réalisme pratique : « On ne peut dire si dans l’avenir, une révolution contre l’urgence surviendra pour mettre fin à l’aliénation temporelle. On ne saurait l’exclure complètement. En l’état actuel des choses, il convient de trouver des répliques, des résistances à l’urgence – une révolte temporelle à défaut d’une révolution. Car attendre pour agir qu’une révolution soit en vue, c’est reconduire un certain immobilisme qui ne fait que trop le jeu du capitalisme. » (p. 248)
Pour Bouton, une fois écartées une à une toutes les « fausses solutions qui, comme un écran de fumée, ne font que reconduire l’urgence » (p. 250), il convient en dernière analyse de chercher des solutions « politiques et juridiques ». À ses yeux, en effet, « le droit peut s’avérer un moyen efficace pour limiter la prédation de ce que le monde de l’économie considère comme l’une des ressources les plus précieuses : le temps. » (p. 267) La norme de l’urgence peut-être combattue par la loi et c’est donc aux élus qu’il appartient « de concevoir et de mettre en œuvre une politique d’aménagement du temps » (p. 267). La longue enquête de l’auteur débouche ainsi sur une position réformiste tout à fait assumée, qu’il prend la peine de détailler dans la dernière section du chapitre.
Bouton commence par rejeter rapidement l’hypothèse d’une réduction supplémentaire du temps de travail, au nom d’arguments que l’on pourrait certainement contester mais qui ne sont pas sans poids. Celle-ci rencontrerait vite en effet, selon lui, l’obstacle de la recherche d’une augmentation de la productivité : « En l’état actuel des choses, toute diminution supplémentaire risquerait même d’intensifier encore le travail, donc d’augmenter l’urgence. » (p. 270) La réduction du temps de travail serait également peu efficace pour contrer l’urgence car on observe que le « temps libéré », qui est pourtant en augmentation constante depuis le XIXe siècle, est depuis quelques décennies quantitativement mais aussi qualitativement colonisé, grâce aux nouvelles techniques de communication, par le temps de travail et sa pression temporelle.
Bouton propose, ensuite, comme l’avaient déjà fait Boltanski et Chiapello en 1999 dans Le Nouvel esprit du capitalisme, mais dans un esprit un peu différent, « un droit à la déconnexion » (p. 274). Celui-ci, en élargissant certains droits déjà existants, comme le « droit à la vie privée et familiale » dans le Code civil ou le « droit au repos » dans le Code du travail, protégerait les salariés de l’invasion de l’urgence professionnelle dans leur temps personnel.
Du côté des employeurs, il propose, là aussi en élargissant un délit déjà défini par le Code du travail – le harcèlement moral –, de « pénaliser l’urgence organisationnelle », c’est-à-dire de rendre illégales toutes les techniques de management par la pression temporelle : « L’urgence est incontestablement une forme de harcèlement moral, plus exactement un harcèlement organisationnel. » (p. 276). Ce type de management, très répandu dans les entreprises depuis les années 1990, devrait être interdit par la loi, mais il faudrait nécessairement également donner aux organisations syndicales le droit de se porter partie civile devant les prud’hommes, voire, dans les cas les plus graves ayant abouti à des phénomènes de burnout ou à des suicides, devant les juridictions pénales (p. 278).
Enfin, Bouton semble envisager une transformation plus large du capitalisme. Contestant implicitement, de manière étrange, certaines de ses propositions précédentes, il note : « Tant qu’on se contente d’agir en aval, par des stratégies individuelles ou des lois protectrices, le processus de l’urgence à toutes les chances de contourner les obstacles et de continuer à s’étendre. Pour stopper son expansion, rendre le travail soutenable, il convient d’intervenir politiquement en amont, sur les causes proprement économiques de l’urgence. » (p. 279) Toutefois, comme Bouton estime une révolution très peu probable et une « alternative au capitalisme » incertaine, il en appelle, « à défaut d’un changement de mode de production », à ce qu’il appelle une « réforme radicale » (p. 279), dont il évoque les contours de manière plus que succincte et un peu obscure. Il faudrait « revoir en profondeur les normes de rentabilité qui gouvernent le monde », par exemple en mettant sur pied un « impôt progressif sur les sociétés », qui permettrait, selon l’auteur, de contrecarrer la logique des rendements exorbitants, ou en créant les conditions d’« un actionnariat durable » par lequel les propriétaires d’actions s’engageraient à conserver celles-ci au moins dix ans (p. 280).
Le côté un peu embrouillé de cette ultime proposition correspond, à mon avis, au fait que le choix politique du réformisme n’est pas totalement assumé. Or, dans la version du marxisme que défend Bouton « l’aliénation » est au fond plus déterminante que « l’exploitation ». Le capitalisme n’y est pas critiqué en premier lieu parce qu’il est un système injuste de répartition de la propriété et d’extraction de la plus-value, mais avant tout parce qu’il produit une souffrance psychique et physique : « L’urgence plonge les individus dans un état d’aliénation temporelle, au sens où ils perdent peu à peu le contrôle de l’usage de leur temps professionnel et privé. D’où une souffrance physique et psychique qui peut entraîner des dépressions et mener jusqu’au suicide. » (p. 239) La version du marxisme défendue par Bouton participe de ce que l’on appelait dans les années 1960-70 le marxisme humaniste et il en a les qualités et les défauts : d’une part, le choix d’une stratégie réformiste agissant dès à présent sur les causes immédiates d’aliénation, les conditions de travail et de vie de la population, et d’autre part le rejet concomitant d’une stratégie révolutionnaire, qui viserait les causes profondes concernant la répartition de la propriété – rejet affirmé assez distinctement au départ mais qui semble revenir hanter l’auteur dans la fin de son raisonnement.
De la critique des loisirs à l’éloge du loisir
Dernière originalité : l’éloge du loisir contre les loisirs. Dans la conclusion de son ouvrage, Bouton revient sur la valeur qu’il lui semble essentiel de promouvoir, notamment au regard des valeurs de second rang qui ont aujourd’hui pignon sur rue : « Le contrepoids à l’urgence n’est ni l’oisiveté, ni la lenteur, mais le loisir. » (p. 283) Pour cela, il en analyse finement les différentes acceptions, présentes déjà dans la skholè ou l’otium antiques. Dès les plus hautes époques, le loisir a été conçu de manières très diverses : comme oisiveté et paresse, comme simple détente après un dur labeur, mais aussi comme ensemble de pratiques ludiques (sports, jeux, thermes, etc.), ou encore comme loisirs studieux. C’est bien sûr cette dernière acception que Bouton met au centre de sa réflexion éthique et politique. Dans son sens le plus noble, le loisir est en effet « un temps libéré des tâches matérielles et des nécessités de la vie ». Il permet au citoyen qui en bénéficie de « se consacrer à une noble tâche utile pour la cité, qui relève de la vie politique ou de la vie contemplative ». Le loisir se caractérise « par un libre usage du temps » (p. 284).
Toute la question est de savoir si nous pouvons « envisager une conception démocratique du loisir » (p. 284), non pas du reste simplement parce que le loisir, chez les Anciens, supposait l’esclavage – auquel il serait facile de suppléer aujourd’hui grâce à l’augmentation de la productivité –, mais bien plus profondément parce qu’il est guetté, chez les Modernes, par au moins deux types de dévoiements : soit il est pensé, comme dans les multiples « éloges de la paresse », en opposition absolue au travail, ce qui ne change rien au caractère aliéné de celui-ci ; soit, lorsqu’il est pluralisé sous la forme « des loisirs », il est perçu comme un temps simplement réparateur ou compensateur, c’est-à-dire dans un rapport de complémentarité au travail, accepté là encore comme aliéné, un temps qui n’échappe pas du reste lui-même à la consommation : « Les loisirs sont la continuation de l’aliénation par d’autres moyens. » (p. 290)
L’ambition de Bouton serait de remettre le loisir dans une relation d’inclusion avec le travail. Non plus l’oisiveté ou les loisirs, mais le loisir actif, studieux ou contemplatif, de toute façon libre : « Le loisir est le temps libre dans le travail, et, faut-il ajouter, après le travail […] Autrement dit, le loisir est à comprendre comme un libre usage du temps tout au long du temps quotidien et du temps de la vie. Réhabiliter le loisir, c’est promouvoir, à rebours de l’urgence, l’idée d’une liberté par rapport au temps. » (p. 285)
Bouton retrouve ici le principe d’« idiorrythmie » déjà exploré par Barthes dans les années 1970 [17], principe auquel on aurait bien aimé qu’il se confronte dans sa belle réflexion conclusive. On ne peut se substituer à l’auteur mais il apparaît déjà dans ces dernières pages au moins une différence avec son prédécesseur. Alors que celui insistait sur le thème d’un « temps à soi », c’est-à-dire choisi librement – tout en reconnaissant d’ailleurs qu’une telle utopie ne pouvait fonctionner que dans un groupe d’individus extrêmement petit –, Bouton introduit une notion supplémentaire qui me semble déterminante. Certes, comme Barthes il y a près de quarante ans, la liberté de l’usage du temps, qu’il soit professionnel ou privé, lui paraît constituer l’enjeu principal des transformations en cours : « Il s’agit de penser une skholè en un sens non aristocratique, un libre usage du temps dans l’activité professionnelle et dans les loisirs, un temps libre pendant le travail et en dehors du travail. » (p. 294) Mais à la différence de Barthes, Bouton pose aussi le problème de la qualité de l’usage du temps ainsi libéré, c’est-à-dire de ce que j’ai proposé d’appeler sa plus ou moins grande rythmicité [18] : « Le loisir ainsi compris est une notion autant qualitative que quantitative : non pas seulement plus de temps libre, mais avant tout un temps plus libre, dans son usage et sa modulation. » (p. 294)
C’est pourquoi, il n’est pas étonnant de constater que Bouton réintroduit dans ces pages de conclusion les résultats de sa réflexion croisée sur la notion d’œuvre dans la tradition marxienne et dans la poétique : « Alors que l’urgence est le temps du dés-œuvrement, de la destruction des œuvres, le loisir est le temps de la réflexion et de la création. » (p. 297) Pas étonnant non plus de le voir citer Montaigne, qui déclarait dans le Tiers livre : « J’y veux pouvoir quelque chose du mien », tout en affirmant que son « grand et glorieux chef-d’œuvre, c’est de vivre à propos ». C’était supposer, commente justement Bouton, que « l’on peut faire de sa vie une œuvre, avec toutes les caractéristiques d’invention et d’endurance que cela implique. » (p. 297) Or, une telle entreprise, poétique au sens le plus fort du terme, porte à l’évidence sur la qualité, c’est-à-dire encore une fois la rythmicité, des rythmes qui organisent nos vies et en déterminent les manières de fluer plus ou moins propre : « On peut appeler tempérance cette capacité à bien user de son temps, à vivre “à propos”, c’est-à-dire selon un rythme modulé, en fonction des activités et des péripéties de l’existence. » (p. 297)
Le tempo à la place du rythme
Je voudrais, pour finir, indiquer les principaux points de l’essai qui pourraient faire l’objet de débats. On a vu comment cette critique de l’urgence s’acheminait petit à petit vers une critique des rythmes du contemporain. C’est à mon avis ce qui fait sa force. Mais, précisément, c’est aussi ce qui rend plus sensible encore ses faiblesses passagères, par exemple lorsque le rythme a tendance à s’effacer, en dépit des précautions prises, derrière la notion de tempo, lorsque la thématique rythmique se perd aux dépens de la seule thématique temporelle prise dans un sens phénoménologique, lorsque Mauss n’est pas reconnu comme un penseur du rythme, ou encore lorsque le langage disparaît du tableau et que les leçons rythmologiques de la poétique sont ignorées au profit de conceptions venant de la rhétorique et de la sociologie pragmatique de l’art. Il ne s’agira ici nullement de remettre en question le travail qui nous est présenté mais au contraire de suggérer quelques pistes de recherche par lesquelles il pourrait être avantageusement et utilement prolongé.
Premier problème : la tendance, inverse à la précédente, à réduire la question du rythme – dont il faut rappeler les dimensions corporelle, langagière et sociale ainsi que l’interprétation désormais nécessaire comme rhuthmos ou « manière de fluer » [19] – à la seule question du tempo et donc d’une certaine métrique des activités. Tout en reprochant à Hartmut Rosa de considérer l’urgence comme une simple « composante subjective de l’accélération du rythme de vie » (p. 71), Bouton fait sienne sa définition de l’accélération comme augmentation du tempo de l’action. C’est le cas explicitement pour la vie quotidienne : « Hartmut Rosa définit ce type d’accélération par la multiplication du nombre d’actions et d’expériences vécues par unité de temps. » (p. 70) Mais c’est aussi le cas, cette fois sans le dire, pour l’urgence juridique définie comme « l’accélération du rythme de production des lois, l’augmentation de la productivité législative » (p. 74) ; et encore, pour l’urgence politique ou l’urgence dans le monde universitaire, qui désignent chez Bouton des augmentations du nombre de « tâches [confiées aux élus ou aux enseignants-chercheurs] à faire en peu de temps » (p. 81) – augmentations qui entraînent pour les premiers un « héraclitéisme juridique » (p. 81) et laissent les seconds dans une « situation de pénurie temporelle » (p. 92), qui les détourne de rendre correctement au public les services auxquels celui-ci devrait avoir droit.
Cette accélération n’est pas en soi contestable ; ce qui l’est plus, en revanche, c’est de s’en tenir à elle et de ne pas envisager, ou pas très clairement, la dimension qualitative des transformations rythmiques récentes. Certes, Bouton note que dans la mesure où toute injonction à agir immédiatement implique l’arrêt de la tâche que l’on était en train de faire, le temps de l’urgence « est liée à la notion d’interruption » et constitue « un temps haché, discontinu – un temps en miettes » (p. 105). Mais ce temps, puisqu’il impose de faire dans la même durée un nombre d’actions de plus en plus grand, implique surtout « la compression et la densification du temps » (p. 106). Et c’est sur cette dimension quantitative qu’il insiste finalement le plus : « La compression signifie que la durée allouée aux tâches à accomplir est réduite le plus possible. Le tempo du travail est accéléré (on joue le même morceau en un temps global plus court). La densification nomme quant à elle une augmentation du nombre des tâches par unité de temps. On assiste ici à la polychronie (l’art de faire plusieurs choses simultanément). Le rythme du travail est accéléré (on joue le même morceau avec plus de notes). […] Compression et densification marchent donc de concert afin de permettre une utilisation exhaustive du temps. » (p. 106)
La phénoménologie comme obstacle épistémologique
Un deuxième problème est lié au recours, au moins dans certaines sections, au Bergson de l’Essai sur les données immédiates de la conscience et à la phénoménologie husserlienne. Dans ces pages, au lieu d’être posé en termes d’individuation et de subjectivation, c’est-à-dire en termes de rythme et de qualité rythmique, le problème de l’urgence est réduit à une « discordance » entre ce qui est présenté comme le temps intérieur, « le temps subjectif de l’individu » et « le temps social » : « L’urgence ne peut qu’étouffer la mélodie intérieure de la durée en installant “l’automate conscient” en lieu et place du Moi profond. L’urgence refoule, recouvre la durée, mais elle ne la supprime jamais. Les individus continuent d’éprouver des sentiments variés, qui colorent chaque moment de leur vie de touches singulières. Mais ce flot qualitatif ne trouve pas à s’exprimer dans le flux tendu des tâches. » (p. 139)
On trouve le même principe de raisonnement et la même difficulté dans la référence à Husserl qui suit : « Les rétentions et les protentions de la conscience, qui désignent les actes par lesquels elle retient le passé immédiat et anticipe le futur proche, transforment le présent ponctuel et fugace en un présent élargi, stable, doté d’une certaine durée étalée sur quelques secondes – ce que Husserl appelle le “présent vivant”. » (p. 140) Or, continue Bouton, « que se passe-t-il lorsque l’urgence est généralisée, comme une norme sociale contraignante, une discipline collective ? Dans ce cas, le processus de quotidianisation du temps est sinon annulé, du moins perturbé. » (p. 141)
Et c’est encore le même type d’approche qui motive les emprunts à Koselleck dont Bouton retient explicitement deux catégories : l’ « horizon d’attente » et le « champ d’expérience ». Le premier est « l’ensemble des événements futurs auxquels l’individu peut s’attendre, dont certains font l’objet de prévisions, de projets, de souhaits, d’espoirs ou de craintes. L’attente a une dimension à la fois affective et intellectuelle. » (p. 143) Le second nomme « l’ensemble des expériences passées de l’individu, sédimentées sous forme de souvenirs et de récits », et médiatisés, « comme Ricœur l’a montré, […] par le langage, c’est-à-dire par la manière dont les individus se racontent à eux-mêmes et racontent à leur entourage ce qu’ils ont vécu. » (p. 145)
Ce type d’approche de l’urgence, qui dissout la question du rythme dans celle de la temporalité, soulève au moins trois problèmes. Tout d’abord, vu les principes durkheimiens posés au départ, on saisit mal à quoi ce « temps subjectif » ou ce « présent vivant », cette « durée étalée sur quelques secondes », font référence, si tant est que pour Durkheim, comme du reste pour Bachelard un peu plus tard dans sa polémique avec Bergson, la durée intérieure n’a aucune existence autonome et que nous n’en prenons jamais conscience que déjà préformée par des scansions d’origine sociale. De même, il est tout aussi difficile de réduire l’avenir et le passé à l’anticipation du désir et à la mémoire individuels. Durkheim lui-même voyait déjà dans les anticipations des projections de la conscience collective et Halbwachs a montré, quelques années plus tard, que la mémoire était une construction sociale.
Ensuite, cette approche réinsère la question de l’urgence dans une problématique dualiste selon laquelle la réalité pourrait être divisée en intérieur et extérieur, individuel et social, nature et culture, moi profond et automate conscient, présent vivant et normes temporelles imposées par la société. Bref, s’il y a une « discordance », elle est plutôt entre l’approche sociologique (Marx, Durkheim, Mauss, Bourdieu) et l’approche phénoménologique (Bergson, Husserl), qui sont simultanément pratiquées par Bouton, de manière un peu optimiste, comme si elles étaient simplement complémentaires, la seconde fournissant l’accès à l’intériorité pendant que la première fournirait l’approche en extériorité.
Enfin, si le diagnostic qui est tiré de ces analyses porte, dans un premier mouvement, sur les dysfonctionnements du système capitaliste qui « dérobe le présent », « atrophie l’avenir » et « déracine le passé » des individus (p. 146-154), il se tourne bientôt vers ces individus qui sont alors accusés de se concentrer « exclusivement sur le présent et le futur à court terme » (p. 157). Insensiblement, l’effet de système devient un défaut psychologique, éthique et politique des individus eux-mêmes, et la critique débouche finalement sur les récriminations habituelles concernant l’opportunisme supposé de « l’homme » contemporain et son repli présumé sur le seul présent aux dépens de l’avenir et du passé : « L’homme en état d’urgence a la mémoire courte. Il n’a pas plus le temps de méditer sur le passé que de penser au futur de sa vie, encore moins à l’avenir de son pays et des prochaines générations. » (p. 159) Alors qu’il prend soin la plupart du temps de s’en distinguer en contestant la thèse réactionnaire d’une fin de la politique (p. 191), Bouton rejoint ici la théorie des contempteurs du « sacre du présent » (Zaki Laïdi), du « présentisme » (François Hartog), de la « tyrannie du présent » et de la « confiscation de l’avenir » (Daniel Innerarity), ou encore du « situationnisme » d’Hartmut Rosa, qu’il aurait pu citer également.
Le manque d’une anthropologie historique du rythme
Un troisième problème apparaît à travers l’erreur d’interprétation concernant le concept maussien de « fait social total » notée plus haut. Certes, cette erreur ne nuit pas à la démonstration de l’auteur, qui se développe en réalité sans véritablement mobiliser ce concept. Mais elle l’a probablement empêché de prendre conscience de ce que Mauss aurait pu lui apporter en termes d’anthropologie historique du rythme [20].
Un « fait social total » est certes, pour Mauss, un fait juridique et économique, mais c’est avant tout un fait morphologique, et c’est aussi un fait qui a des dimensions religieuses et esthétiques : « Tout s’y passe, résume Mauss, au cours d’assemblées, de foires et de marchés, ou tout au moins de fêtes qui en tiennent lieu. Toutes celles-ci supposent des congrégations dont la permanence peut excéder une saison de concentration sociale, comme le potlatch d’hiver des Kwakiutl, ou des semaines, comme les expéditions maritimes des Mélanésiens. [21] » Autrement dit, il ne s’agit pas d’un fait qui se manifeste dans toute la société, mais d’un fait social où se manifeste la société ou le groupe tout entiers et où le sociologue peut exceptionnellement les saisir dans leur dynamique essentielle : « Ce sont des “touts”, des systèmes sociaux entiers dont nous avons essayé de décrire le fonctionnement. Nous avons vu des sociétés à l’état dynamique ou physiologique. Nous ne les avons pas étudiées comme si elles étaient figées, dans un état statique ou plutôt cadavérique, et encore moins les avons-nous décomposées et disséquées en règles de droit, en mythes, en valeurs et en prix. » (Ibid.) Lors de ces temps forts des rythmes morphologiques, les échanges s’intensifient tout en suivant des règles rituelles très précises, des danses et des représentations dramatiques sont exécutées, des chants et des poèmes sont échangés, les ancêtres sont toujours présents et c’est souvent à eux que l’on offre les dons. Or, dans toutes ces activités rythmées, socialement, mais aussi discursivement et corporellement, ce sont la société, les groupes et les personnes qu’elle contient, qui se régénèrent. Un « fait social total », au moins tel que le conçoit Mauss, est un des moments principaux du processus permanent d’individuation singulière et collective : « C’est en considérant le tout ensemble que nous avons pu percevoir l’essentiel, le mouvement du tout, l’aspect vivant, l’instant fugitif où la société prend, où les hommes prennent conscience sentimentale d’eux-mêmes et de leur situation vis-à-vis d’autrui. » (Ibid.)
Je ne prolonge pas la démonstration, mais il me semble que cette anthropologie profondément historique – qui diffère, on le voit, très sensiblement de la version lévi-straussienne la plus couramment admise aujourd’hui – aurait pu être fort utile à une meilleure compréhension des évolutions des rythmes de la vie imposées par le capitalisme mondialisé.
L’absence de la théorie du langage et de la poétique
Un quatrième problème, lié me semble-t-il à la domination des références phénoménologiques mais aussi marxistes et sémiotiques dans le discours de Bouton, tient à l’absence de considération sur le langage – au sens humboldtien d’activité signifiante [22]. Si l’on s’en tient aux analyses présentées dans cet essai, on pourrait avoir l’impression que cette activité, fondamentale pour l’individuation et éventuellement la subjectivation [23], n’est pas touchée par l’urgence. Or, même si les analyses précises de ces phénomènes sont encore très peu nombreuses, il semble assez clair que le langage n’échappe pas à sa pression insidieuse. Dans les grands réseaux médiatiques, qui sont eux aussi traversés par la course à la productivité et donc aux profits, le langage est soumis à une logique d’accélération et de turn over, qui entraîne non seulement son appauvrissement lexical et syntaxique mais aussi et surtout l’effondrement de sa puissance individuante et subjectivante. L’archétype de ce discours formaté par l’urgence, de ce discours lisse et purement technique, sans qualité poétique ni puissance critique, c’est celui de la première chaîne « globale », CNN, qui ne parle jamais de littérature et évite soigneusement toute prise de position qui pourraient lui faire perdre des parts d’audience [24]. Mais c’est une évolution que l’on peut constater dans la plupart des grands médias, qui ont désormais comme objectif moins d’informer leurs publics, de leur permettre le débat citoyen ou même de les faire rêver, que de leur servir un flux discursif continu susceptible de porter le maximum d’éléments publicitaires dans le temps le plus court possible.
Un dernier problème, connexe au précédent, tient au manque, sinon de perspectives du moins de références poétiques. Comme la théorie du langage, la poétique est largement absente de l’essai de Bouton. Du coup, les remarques très pertinentes concernant la question de l’œuvre et du dés-œuvrement notées plus haut se retrouvent associées à des considérations qui ne les justifient pas vraiment, voire contrecarrent le déploiement de leur puissance théorique et critique. Bien qu’elle soit abordée empiriquement de manière très juste, la question de l’œuvre est théoriquement déconnectée de la question du sujet, qui en forme pourtant le cœur. De manière très significative de ces zigzags épistémiques, Bouton cite Guillaume le Blanc, qui souligne, tout à fait justement, que l’œuvre « désigne la créativité de la vie ordinaire » et « transforme le patrimoine de l’humanité dans lequel [elle] s’inscrit » (p. 177), mais qui simultanément, prônant une approche typologique d’esprit pragmatique, définit non pas l’œuvre du reste mais « l’acte de “faire œuvre” » – expression qui pose un problème tant que le terme d’œuvre n’a pas été défini – comme se situant « à mi-chemin entre la création de l’œuvre d’art singulière et la production de l’objet banal » et se traduisant, suivant un point de vue esthétique et rhétorique des plus faibles, par un « style », lui-même conçu, suivant le cliché bien connu, comme un écart par rapport à une norme : « Il fait surgir un style dans la manière d’user (de tourner, retourner, détourner) des règles qui encadrent l’activité de travail » (p. 177) Répétant cette oscillation, Bouton voit lui-même « l’acte de faire œuvre » à la fois comme « la participation “à une histoire plus grande que la sienne” » et « l’invention d’une “allure”, d’un style de vie singulière » (p. 177). De même, plus loin, il affirme simultanément, que, lorsque le travail est soumis à l’urgence, « l’inscription dans une histoire plus vaste se réduit à une activité éphémère qui ne laisse aucune trace », et que « l’invention est remplacée par la répétition, le style est dilué dans l’anonymat de fonctions interchangeables » (p. 178).
Or, il n’y a pas pire approche de la question de l’œuvre – et du sujet poétique qu’elle implique nécessairement. Comme Foucault à la fin de sa vie, Guillaume le Blanc, et Bouton avec lui, tombent dans le piège du concept de « style ». Comme lui, ils reprennent à leur compte la vieille lune rhétorique de l’écart par rapport aux normes (tourner, retourner, détourner les règles), dont la critique a pourtant été faite depuis longtemps. Comme plus récemment chez Mariel Macé, on voit ainsi leur discours s’orienter dans la bonne direction puis refluer vers des positions dualistes, para-normatives et individualistes, tout à fait traditionnelles [25]. L’ouverture du sujet poétique sur l’histoire est alors à la fois affirmée et contrecarrée par le repli sur le soi qu’implique les notions d’individu et de norme. Le résultat est une éthique et peut-être aussi une politique moins claires qu’il n’y paraît. Ce n’est pas tant le sujet en tant qu’agent qui y est en jeu, c’est-à-dire sa puissance d’agir et d’exister, que l’individu dans son for intérieur et sa vie privée, posé de manière non dialectique en opposition à une Loi qu’il s’agirait simplement de tourner ou détourner : « [L’urgence permanente] sape les conditions d’une vie bonne parce qu’elle s’attaque à la structure même du temps de l’individu à tous ses niveaux : temps quotidien, temps de la vie, temps de l’histoire. » (p. 186)
La fréquence d’une telle mésaventure doit être prise en bonne et mauvaise part : d’un côté, elle montre que quelque chose est en train de se chercher et se trouve prêt à émerger ; de l’autre, elle souligne la nécessité, pour tous les chercheurs intéressés par les enjeux éthiques et politiques de l’art et qui pensent y trouver une solution à leurs interrogations, d’abandonner une bonne fois pour toutes leurs présupposés rhétoriques et de se tourner vers les acquis de la poétique et de l’anthropologie historique de ces quarante dernières années. Cela fait longtemps maintenant qu’il n’est plus possible de définir l’œuvre « selon son concept classique » par « son style et son endurance », « un style inédit, une originalité, […] résultat d’une activité créatrice » (p. 179).
En dépit de ces quelques critiques, on aura compris que je trouve ce livre tout à fait remarquable : non seulement parce qu’il allie clarté dans l’exposition, honnêteté dans la discussion et pertinence dans le choix de ses principaux appuis théoriques, mais aussi parce qu’il témoigne, à mon sens, de manière très significative, d’un mouvement de pensée actuellement en voie d’émergence, qui place la question de l’organisation temporelle des processus d’individuation, c’est-à-dire la question du rythme, au centre de ses préoccupations [26].