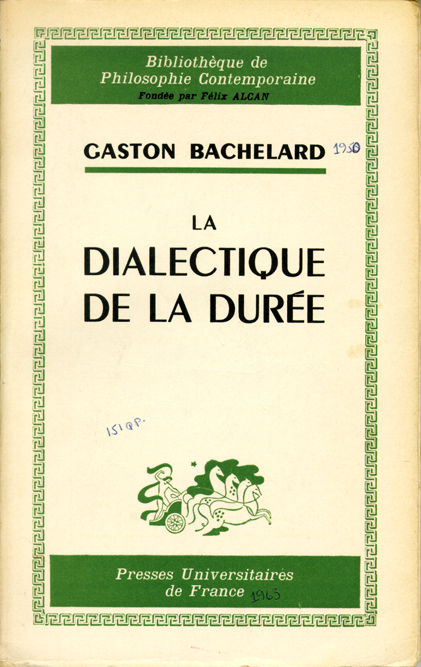G. Bachelard, La Dialectique de la durée (1936), Paris, PUF, 1950.
Cette étude ne peut guère perdre son obscurité que si nous en fixons tout de suite le but métaphysique : elle s’offre comme une propédeutique à une philosophie du repos. Mais, comme on le verra dès les premières pages, une philosophie du repos n’est pas une philosophie de tout repos. Un philosophe ne peut pas chercher tranquillement la quiétude. Il lui faut des preuves métaphysiques pour qu’il accepte le repos comme un droit de la pensée ; il lui faut des expériences multiples et de longues discussions pour qu’il admette le repos comme un des éléments du devenir. Le lecteur devra donc pardonner le caractère tendu d’un livre qui fait bon marché des conseils et des exemples familiers pour aller tout de suite à la conviction que le repos est inscrit au cœur de l’être, que nous devons le sentir au fond même de notre être, intimement mêlé au devenir imparti à notre être, au niveau même de la réalité temporelle sur laquelle s’appuient notre conscience et notre personne.
Mais quand le lecteur aura pardonné à un philosophe de manquer d’enjouement, il devra encore faire face à une autre désillusion. En effet, dans cet ouvrage, on n’a pas cru devoir décrire la perspective qui mène à la vie secrète et paisible. Il aurait fallu pour cela des pages et des pages et toute une psychologie des passions que nous avons perdu le goût d’étudier puisque nous devons faire profession de les refuser. Nous pouvions donc profiter de l’heureux âge où l’homme est rendu à lui-même, où la réflexion s’occupe plutôt à organiser l’inaction qu’à servir des exigences externes et sociales. Tout ce qui a égard à l’éloignement du monde, à la défense de la vie retirée, à l’affermissement de la solitude morale, nous en avons, comme trop élémentaire, laissé l’étude de côté. Que chacun fasse à sa guise les premiers pas sur la route qui mène à la fontaine de Siloë, aux sources mêmes de la personne. Que chacun se libère, à sa manière, des excitations contingentes qui l’attirent hors de soi-même ! C’est dans la partie impersonnelle de la personne qu’un philosophe doit découvrir des zones de repos, des raisons de repos, avec lesquelles il fera un système philosophique du repos. Par la réflexion philosophique, l’être se libérera d’un élan vital qui l’entraîne loin des buts individuels, qui se dépense en des actions imitées. L’intelligence, rendue à sa fonction spéculative, nous apparaîtra comme une fonction qui crée et affermit des loisirs. La conscience pure nous apparaîtra comme une puissance d’attente et de guet, comme une liberté et une volonté de ne rien faire.
Nous avons été ainsi conduit tout naturellement à un examen des puissances négatrices de l’esprit. Cette négation, nous l’avons examinée tout de suite à sa racine, reconnaissant que l’esprit pouvait heurter la vie, s’opposer à des habitudes invétérées, faire en quelque manière refluer le temps sur lui-même pour susciter des rénovations de l’être, des retours à des conditions initiales. Pourquoi ne considérerions-nous pas comme également importantes les actions négatives et les actions positives du temps ? Puisque nous prétendions aller aussi vite que possible au centre métaphysique du problème, c’était une dialectique de l’être dans la durée qu’il fallait fonder. Or, dès que nous avons été un peu exercé, par la méditation, à vider le temps vécu de son trop-plein, à sérier les divers plans des phénomènes temporels, nous nous sommes aperçu que ces phénomènes ne duraient pas tous de la même façon et que la conception d’un temps unique, emportant sans retour notre âme avec les choses, ne pouvait correspondre qu’à une vue d’ensemble qui résume bien mal la diversité temporelle des phénomènes. Un botaniste qui bornerait sa science à dire que toutes les fleurs se fanent serait le digne émule du philosophe qui fonde sa doctrine en répétant : tout s’écoule et le temps fuit. Nous avons vu bien vite qu’il n’y a nul synchronisme entre cet écoulement des choses et la fuite abstraite du temps et qu’il fallait étudier les phénomènes temporels chacun sur un rythme approprié, à un point de vue particulier. Examinée dans sa contexture, sur n’importe lequel de ses plans et à la condition de s’astreindre à rester sur un même plan d’examen, nous avons vu la phénoménologie comporter toujours une dualité des événements et des intervalles. Bref, prise dans le détail de son cours, nous avons toujours vu une durée précise et concrète fourmiller de lacunes.
Établir métaphysiquement – contre la thèse bergsonienne de la continuité – l’existence de ces lacunes dans la durée devait être notre première tâche. Il nous a donc fallu commencer par discuter la fameuse dissertation bergsonienne sur l’idée de néant et entreprendre de ramener l’équilibre entre le passage de l’être au néant et du néant à l’être. Cette base était indispensable pour fonder l’alternative du repos et de l’action.
À notre avis, ce débat n’est pas vain, car en s’appuyant sur une conception dialectique de la durée, on facilite, comme nous avons entrepris de le montrer dans une suite de chapitres, la solution des problèmes posés par la causalité psychologique, ou, pour parler plus exactement, par les causalités psychologiques. En examinant, feuillet par feuillet, les divers plans d’enchaînement du psychisme, on aperçoit les discontinuités de la production psychique. S’il y a continuité, elle n’est jamais dans le plan où l’on exerce un examen particulier. Par exemple, la « continuité » dans l’efficacité des motifs intellectuels ne réside pas dans le plan intellectuel ; on la suppose dans les plans des passions, des instincts, des intérêts. Les concaténations psychiques sont donc souvent des hypothèses. Bref, à notre avis, la continuité psychique pose un problème et il nous semble impossible qu’on ne reconnaisse pas la nécessité de fonder la vie complexe sur une pluralité de durées qui n’ont ni le même rythme, ni la même solidité d’enchaînement, ni la même puissance de continu.
Naturellement, si nous pouvions transmettre au lecteur notre conviction que la continuité psychique est, non pas une donnée, mais une œuvre, il nous resterait à montrer comment se construit une durée, comment se fondent les permanences de l’être au niveau de ses divers attributs.
Dans cette tâche difficile, nous avons été encouragé par des doctrines diverses. D’abord par une doctrine vivante, enseignée le long des chemins de Bourgogne, au coin des vignes. Devant cette campagne humanisée, M. Gaston Roupnel nous a fait comprendre le lent ajustage des choses et des temps, l’action de l’espace sur le temps et la réaction du temps sur l’espace. La plaine labourée nous peint des figures de durée aussi clairement que des figures d’espace ; elle nous montre le rythme des efforts humains. Le sillon est l’axe temporel du travail et le repos du soir est la borne du champ. Comme une durée coulant d’un flot continu et régulier exprimerait mal ces moules temporels ! Combien plus réelle, comme base de l’efficacité temporelle, doit apparaître la notion de rythme !
Du passé historique, nous enseigne encore M. Gaston Roupnel, qu’est ce qui demeure, qu’est ce qui dure ? Cela seul qui a des raisons de recommencer. Ainsi, à côté de la durée par les choses, il y a la durée par la raison. Il en va toujours de même : toute durée véritable est essentiellement polymorphe ; l’action réelle du temps réclame la richesse des coïncidences, la syntonie des efforts rythmiques. Nous ne serons des êtres fortement constitués, vivant dans un repos bien assuré, que si nous savons vivre sur notre propre rythme, en retrouvant, à notre gré, à la moindre fatigue, au moindre désespoir, l’impulsion de nos origines. C’est ce qu’illustre le beau mythe de Siloë qui nous enseigne la restitution courageuse, volontaire, raisonnée, de notre âme d’autrefois. Nous avons étudié ce mythe dans un livre spécial [1]. Nous n’y reviendrons donc plus ; mais il a si vivement marqué notre pensée que nous devions le rappeler au seuil de ce nouveau travail.
Si ce qui dure le plus est ce qui se recommence le mieux, nous devions ainsi trouver sur notre chemin la notion de rythme comme notion temporelle fondamentale. Nous étions alors amené à poser une thèse en apparence bien paradoxale mais que nous nous efforcerons de légitimer. C’est que les phénomènes de la durée sont construits avec des rythmes, loin que les rythmes soient nécessairement fondés sur une base temporelle bien uniforme et régulière. Nous avons pu, sur ce point, aboutir à quelques pages condensées en nous servant surtout des enseignements contenus dans les livres de MM. Maurice Emmanuel, Lionel Landry, Pius Servien. Nous avons choisi ces livres pour soutenir une thèse métaphysique précisément parce qu’ils n’ont aucune visée métaphysique. Il nous a semblé qu’ils pourraient plus naturellement nous aider à dégager le caractère essentiellement métaphorique de la continuité des phénomènes temporels. Pour durer, il faut donc se confier à des rythmes, c’est-à-dire à des systèmes d’instants. Les événements exceptionnels doivent trouver en nous des résonances pour nous marquer profondément. De cette banalité : « La vie est harmonie » nous oserions donc finalement faire une vérité. Sans harmonie, sans dialectique réglée, sans rythme, une vie et une pensée ne peuvent être stables et sûres : le repos est une vibration heureuse.
Enfin, il y a quelques années, nous avons reçu confidence d’une œuvre importante qui, à notre connaissance, n’a pas encore paru en librairie. Cette œuvre porte ce beau titre, lumineux et suggestif : La rythmanalyse [2]. À la pratiquer, nous avons acquis la conviction qu’il y a place, en psychologie, pour une rythmanalyse dans le style même où l’on parle de psychanalyse. Il faut guérir l’âme souffrante – en particulier l’âme qui souffre du temps, du spleen – par une vie rythmique, par une pensée rythmique, par une attention et un repos rythmiques. Et d’abord débarrasser l’âme des fausses permanences, des durées mal faites, la désorganiser temporellement. Au temps des Novalis, des Jean-Paul Richter, des Lavater, la mode fut de désorganiser les psychismes figés dans des formes de sentimentalités contingentes, sans force par conséquent pour mener des vies esthétiques et morales [3]. Mais cette désorganisation, menée sur le plan sentimental, reste pour nous trop grossière. Nous avons, là encore, essayé de poursuivre plus loin notre philosophie de la négativité et de porter nos efforts de dissociation jusqu’au tissu temporel, délirant les rythmes mal faits, apaisant les rythmes forcés, excitant les rythmes trop languissants, cherchant des synthèses de l’être dans la syntonie du devenir, animant enfin toute la vie sagement ondulée par les timbres légers de la liberté intellectuelle. Parfois, dans des heures heureuses et trop rares, nous avons retrouvé des rythmes plus naturels, plus simples, plus tranquilles. De ces séances de rythmanalyse nous sortions rasséréné. Notre repos s’égayait, se spiritualisait, se poétisait, en vivant ces diversités temporelles bien réglées. Si mal préparé que nous fussions à ces émois par notre pauvre culture abstraite, il nous semblait que les méditations rythmanalytiques nous apportaient une sorte d’écho philosophique des joies poétiques. Subitement, nous trouvions des passages, des accords, des correspondances toutes baudelairiennes entre la pensée pure et la poésie pure. Nous n’allions pas seulement d’un sens à un autre sens, mais des sens à l’âme. La poésie ne serait donc pas un accident, un détail, un divertissement de l’être ? Elle pourrait être le principe même de l’évolution créatrice ? L’homme aurait un destin poétique ? Il serait sur Terre pour chanter la dialectique des joies et des peines ? Il y a là tout un ordre de questions que nous n’avions pas qualité pour approfondir. Nous avons donc réduit notre tâche au minimum et, dans un court chapitre qui termine notre livre, nous avons résumé les thèses les plus marquantes de l’œuvre de M. Peinheiro dos Santos en les tournant légèrement dans le sens d’une philosophie idéaliste où le rythme des idées et des chants commanderait peu à peu le rythme des choses.